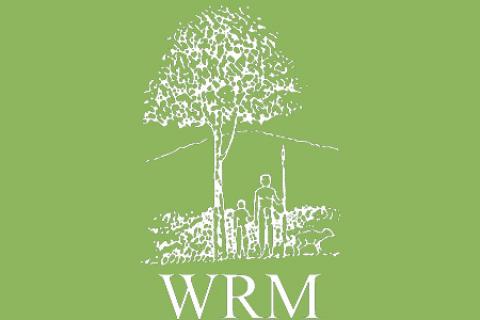Les Baka sont entre 30 000 et 40 000, et ils habitent les régions Sud et Sud-est du Cameroun. Ils sont associés aux Bagando Bakwele, aux Knonbemebe, aux Vonvo, aux Zime, aux Dabjui et à d’autres agriculteurs. La plupart des Baka vivent encore de la chasse et de la cueillette et, bien que certains d’entre eux fassent aussi des cultures annuelles, souvent sur les terres de propriétaires bantous, ils dépendent principalement de la forêt. Beaucoup de communautés locales les reconnaissent comme « les gens de la forêt », car c’est là que leurs ancêtres les ont trouvés à leur arrivée.
Articles de bulletin
Les Pygmées Mbendjele Yaka habitent le Nord du Congo-Brazzaville. Les Mbendjele se réclament de la même ascendance que d’autres groupes de chasseurs cueilleurs de la région, tels que les Baka, les Mikaya, les Luma et les Gyeli, qu’ils appellent des Yaka. Il est fréquent que les étrangers les appellent tous Pygmées ; eux-mêmes utilisent parfois cette dénomination. Ces chasseurs-cueilleurs forestiers sont considérés, par eux-mêmes et par leurs voisins agriculteurs, les Bilo, comme les premiers habitants de la région.
Il faudrait d’abord préciser ce que nous appelons des peuples ou des populations « en isolement volontaire ». Ce terme et d’autres semblables (« écartés », « isolés », « autonomes ») prétendent décrire une situation ou un contexte historique. Ils ont tous en commun qu’ils visent à définir les peuples (idéalement) ou les populations (ce qui est peut-être plus proche de la réalité) qui ont peu de contact ou aucun contact systématique avec des agents occidentaux (en général, des entreprises commerciales ou des missions religieuses).
Les Nukak sont un peuple nomade de l’Amazonie colombienne ; ils ont été officiellement contactés en 1988. La population actuelle est estimée à 390 personnes, distribuées en 13 groupes locaux qui habitent la région comprise entre le cours moyen du Guaviare et le cours supérieur de l’Inírida. La langue nukak s’apparente à celle des Kakua ou Bara, du département colombien du Vaupés, les deux appartenant à la famille linguistique Makú-Puinave.
La culture et la société des Huaorani sont modelées par leur volonté d’isolement. On connaît très peu de leur passé, excepté qu’ils ont été pendant des siècles des groupes autarciques et nomades refusant farouchement tout contact, commerce ou échange avec leurs puissants voisins, que ce soit des indigènes ou des colons blancs ou métis. Depuis leur rencontre tragique avec des missionnaires nord-américains en 1956, les Huaorani ont une place particulière dans l’imagination populaire et journalistique, qui les considère comme « les derniers sauvages de l’Équateur ».
Les Ayoreo habitent une zone de leur territoire ancestral appelée Amotocodie. Sur notre carte moderne, elle figure comme une région de forêt vierge dont le centre est situé à 21º 07’ de latitude sud et 60º 08’ de longitude ouest, une cinquantaine de kilomètres au sud du Cerro León. Ils sont cinquante environ, partagés en plusieurs groupes. Ce n’est pas souvent qu’ils viennent boire l’eau d’un étang dans une estancia, où un travailleur les apercevra peut-être de loin.
En 1990, l’État péruvien établit la réserve de Kugapakori Nahua pour protéger la vie, les droits et les territoires des peuples indigènes du sud-est du Pérou en évitant ou en limitant strictement leur contact avec la société nationale. Pourtant, ces territoires protégés (du moins sur le papier) ont toujours été, depuis la création de la réserve, constamment menacés par l’exploitation forestière illégale.
Des étrangers sont en train d’envahir la réserve de la tribu isolée des Jarawa, dans les îles Andaman de l’Inde, pour voler le gibier dont elle se nourrit. De plus en plus de rapports signalent en outre que les femmes Jarawa sont sexuellement exploitées. Bien que la Haute Cour ait donné à l’administration de l’île l’ordre de fermer l’autoroute qui traverse la réserve, cette route reste ouverte et permet l’entrée de la maladie et de la dépendance.
Il existe dans la région de Banten de Java orientale, en Indonésie, une petite communauté qui a réussi, pour une large mesure, à éviter l’avance de la mondialisation, la technologie moderne et autres influences du monde extérieur, ainsi que la dégradation environnementale. Les Baduy sont un groupe tribal isolé qui a mené son mode de vie traditionnel presque sans perturbation pendant plus de 400 ans, jusqu’à une époque récente où les pressions économiques et sociales de l’extérieur ont commencé à peser sur leur société fermée.
Lorsque les premiers conquistadors remontèrent l’Amazone au XVIe siècle, ils trouvèrent des villages populeux, des structures hiérarchiques et des systèmes agricoles complexes tout le long du fleuve. Ils rapportèrent que les ‘Indiens’ élevaient des tortues dans des bassins d’eau douce construits dans les lagunes, avaient d’abondantes réserves de poisson séché, fabriquaient des poteries vernissées sophistiquées et possédaient d’énormes jarres d’une capacité de cent gallons chacune.
Rede Alerta Contra o Deserto Verde (Réseau Alerte Désert Vert), qui réunit une centaine d’organisations non gouvernementales, de mouvements sociaux, d’associations, de syndicats et de fondations de quatre États brésiliens (Espirito Santo, Bahia, Rio de Janeiro et Minas Gerais) a convoqué les habitants de l’État d’Espirito Santo, la presse et les autorités politiques à participer aux manifestations prévues pour les 20 et 21 septembre.
Le Forest Stewardship Council (FSC) fut créé en 1993, avec la mission de promouvoir une gestion des forêts du monde appropriée pour l’environnement, bénéfique pour la société et viable du point de vue économique. Les normes de gestion forestière du FSC sont fondées sur les 10 « Principes et Critères du FSC pour une gestion responsable des forêts ».