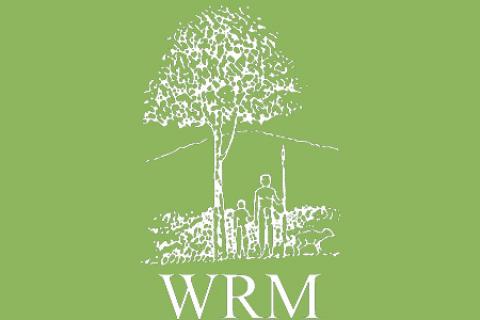Un projet concernant les Sundarbans, région riche en biodiversité, rencontre la ferme opposition des environnementalistes et de la population locale, qui craignent qu’il ne porte atteinte à la mangrove la plus large du monde.
En partenariat avec l’État, le groupe Sahara, basé à Lucknow, entend lancer un projet « écotouristique » gigantesque et controversé, dont les experts préviennent qu’il ferait plus de mal que de bien à cette région écologiquement fragile.
Articles de bulletin
Au Cambodge, plus de 80 % de la population habitent des zones rurales ; 36 % gagnent moins de 0,50 dollars US et vivent dans un état de pauvreté extrême. Malgré le fait que beaucoup de villageois vivent des produits forestiers, la déforestation fait partie de la politique et de l’économie nationales. Les critiques disent que les autorités locales et étatiques ne s’occupent des besoins des pauvres qu’en paroles.
Le groupe indien d’action pour l’environnement, Kalpavriksh, vient de réimprimer un rapport intitulé « Undermining India - Impacts of mining on ecologically sensitive areas », qui avait été publié en mars 2003.
La Malaisie est l’un des plus grands producteurs et exportateurs mondiaux de bois tropical. D’importantes transnationales forestières y ont leur siège, y compris Rimbunan Hijau, un conglomérat de sociétés contrôlé par la famille Tiong du Sarawak, Malaisie.
L’Organisation mondiale du Commerce (OMC) a été l’un des principaux instruments de l’avancée des groupes économiques et de pouvoir qui soutiennent la privatisation, la mondialisation et la libéralisation de l’économie dans le but de commercialiser jusqu’aux recoins les plus cachés de la vie.
Dans les profondeurs de l’Amazonie brésilienne, un bûcheron traverse la frontière du Pérou et pénètre dans le territoire tribal des Ashaninka, où il coupe un autre vieil acajou et le traîne vers le fleuve pour qu’il flotte en aval vers un camion qui l’emportera vers les marchés internationaux.
Lorsque le Chili a adhéré à la Convention de Ramsar en 1981, le Sanctuaire Carlos Anwandter sur le fleuve Cruces a été inclus dans la liste des Zones humides d’importance internationale, surtout en raison de son caractère d’habitat d’oiseaux aquatiques. Il héberge une grande diversité d’espèces de flore et de faune, en particulier le cygne à cou noir (Cygnus melancoryphus), un oiseau migrateur menacé d’extinction. Le Sanctuaire et ses cygnes font partie de l’identité et de l’image des habitants de la ville voisine de Valdivia, étroitement liés au paysage fluvial.
Il y a exactement six ans, nous avons eu l’occasion de visiter l’état de Portuguesa, au Venezuela, dans le but d’obtenir des informations de première main sur la situation des populations de Morador et Tierra Buena par rapport aux grandes plantations d’eucalyptus, de pins et de melinas (Gmelina arborea) de l’entreprise Smurfit Cartón de Venezuela, propriété de la transnationale Smurfit Corporation basée en Irlande.
Depuis que la science forestière occidentale a défini les forêts comme destinées essentiellement à la production de bois, tous les efforts se sont concentrés dans le développement de ce seul produit. Ainsi, des forêts diverses ont été simplifiées, dépouillées de toutes les espèces auxquelles l’industrie du bois ne s’intéressait pas au profit de la prédominance absolue des arbres « de valeur ».
Je suis peut-être naïf, mais je croyais vraiment que la Banque mondiale aurait une position au sujet des arbres GM. Le premier essai sur le terrain d’arbres GM eut lieu en 1988. Je pense que seize années auraient dû suffire pour que les experts en politique de la Banque présentent quelque chose.
En juin 2004, un groupe d’activistes non identifiés a attaqué le dernier essai sur le terrain d’arbres génétiquement modifiés qui restait en Finlande. Environ 400 bouleaux transgéniques ont été abattus. En tant que militants contre les arbres GM, nous nous sommes demandé alors comment nous devions réagir.
Du 17 au 19 novembre 2004, une importante rencontre sur la technologie des arbres génétiquement modifiée a eu lieu à la Duke University de North Carolina, aux États-Unis. Les participants étaient les représentants des principales entreprises biotechnologiques (Arborgen, Cellfor et d’autres), ceux des institutions de recherche leaders (Institute of Forest Biotechnology, Department of Energy’s Joint Genome Initiative) et des ministères des Forêts des États-Unis et du Canada, et bien d’autres qui voulaient tout simplement savoir davantage sur la technologie des arbres GM.