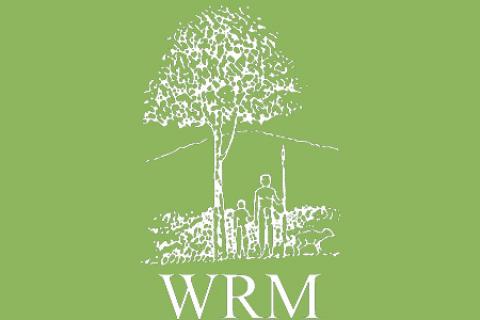Le 17 avril, plus de 400 soldats des forces spéciales de l’armée équatorienne sont entrés au Détachement Tigre, situé sur la frontière sud-est du Pérou, province de Pastaza, soi-disant pour « capturer, neutraliser et anéantir deux groupes guérilleros » détectés dans la région. Ce territoire appartient à la communauté quichua Yana Yaku, siège de l’Organisation des Peuples autochtones de Pastaza (OPIP), elle aussi occupée le même jour par surprise par 80 militaires, accusée d’être le « foyer de l’appui logistique » de groupes prétendument subversifs.
Articles de bulletin
La Réserve naturelle de Galibi est mondialement célèbre en tant que lieu de ponte de quatre espèces de tortues menacées. Établie en 1969, elle couvre environ 400 hectares et reçoit une affluence permanente de touristes des États-Unis et de partout ailleurs.
Pourtant, ce qui est moins bien connu est que’elle fait partie du territoire ancestral des Kalinya du Bas Marowijne River, et que ce peuple a directement subi les conséquences de l’établissement de cette aire protégée.
La Mélanésie, qui comprend la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, Vanuatu, Kanaky (la Nouvelle-Calédonie), les Fidji, le Timor-Oriental et la Papouasie occidentale (Indonésie), est unique au monde du fait que 95% de son territoire appartiennent encore aux autochtones sous la forme de propriété communautaire. Les forêts sous leur contrôle font partie des plus grandes forêts tropicales de la région Asie-Pacifique, qui figurent en troisième place après celles de l’Amazone et du Congo.
La quatrième session du Forum des Nations unies sur les forêts (FNUF-4) se tiendra du 3 au 14 mai 2004 à Genève, pour examiner la mise en oeuvre des propositions d’action du Groupe intergouvernemental sur les forêts (GIF) et du Forum intergouvernemental sur les forêts (FIF) dans cinq domaines : aspects sociaux et culturels des forêts ; savoir traditionnel sur les forêts ; savoir scientifique sur les forêts ; suivi, évaluation et rapport, concepts, terminologie et définitions ; critères et indicateurs de gestion durable des forêts.
Bien que très éloignée des forêts tropicales amazoniennes, la Colombie britannique (BC), qui est la province la plus occidentale du Canada, a été baptisée « le Brésil du Nord » en raison du rythme de destruction de ses forêts, où dominent les grandes propriétés commerciales et l’extraction à grande échelle. Or, un petit vent de changement a commencé à souffler avec l’apparition des forêts communautaires, accompagnée de nouvelles méthodes d’aménagement et de gestion.
A quoi nous référons-nous lorsque nous parlons de l’aménagement ou de la gestion communautaire des forêts ? Quelles idées sont derrière cette terminologie ? Voyons d’abord le mot « aménagement ». D’après le dictionnaire, il dérive de mesnage, un terme qui, au XIVe siècle notamment, désignait le bois de construction ou les ustensiles de bois. Plus proche de notre époque, l’aménagement est défini en 1771 comme un terme appartenant au domaine de la sylviculture et désignant la réglementation des coupes et l’exploitation d’une forêt.
Pourquoi les pratiques millénaires d’utilisation de la forêt, que l’on appelle aujourd’hui « gestion communautaire des forêts », sont-elles nées au sein des collectivités traditionnelles ? Pourquoi de telles pratiques ont-elles été quelque chose de naturel pour ces populations ?
En 2002, un certain nombre d’organisations et d’individus qui travaillaient ensemble pour influer sur le Sommet mondial pour le développement durable (SMDD) organisèrent le Caucus mondial sur la gestion communautaire des forêts, et celui-ci réussit à pousser les délégués gouvernementaux à « reconnaître et soutenir les systèmes autochtones et communautaires de gestion forestière de manière à assurer une participation pleine et efficace des populations locales et autochtones à la gestion durable des forêts » (article 45-h du Rapport du SMDD).
Cela fait des années que les gouvernements débattent des forêts et passent des accords « juridiquement contraignants » et « non juridiquement contraignants » dans le but déclaré de protéger les forêts du monde. Il peut donc être utile d’examiner ces accords du point de vue de l’aménagement communautaire des forêts, pour savoir quel est le rôle – si rôle il y a – assigné par les gouvernements aux populations qui habitent les forêts ou qui en sont tributaires.
Le Sommet de la Terre de 1992
En avril, la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI) fêteront leur 60e anniversaire, et les militants du monde entier ont déjà commencé à organiser des activités visant à exposer le rôle de ces institutions dans l’imposition d’un modèle économique dévastateur pour la société et l’environnement, destiné à favoriser les intérêts commerciaux du Nord (pour davantage d’information, voir http://www.50years.org ).
« Pas d’or sale » est la devise de la campagne adressée aux consommateurs et lancée le 11 février 2004 par Earthworks-Mineral Policy Center et Oxfam, dans le but de secouer l’industrie aurifère et de changer la manière dont l’or est extrait, acheté et vendu.
Le 12 février dernier, plus de 100 organisations de défense de l’environnement, du développement et des droits humains ont constitué une alliance unique dans la République démocratique du Congo pour s’opposer, dans ce pays ravagé par la guerre, à un « développement » des forêts humides qui impliquerait une accélération considérable de leur exploitation industrielle.