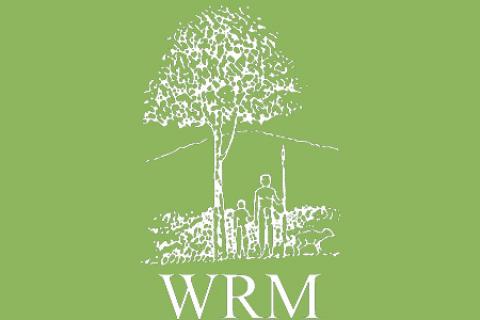Les statistiques concernant le Swaziland sont déprimantes. Le chômage atteint 40 %. Plus des deux tiers de la population vivent avec un revenu de moins d'un dollar par jour. Un tiers des habitants du pays dépendent de l'aide alimentaire pour survivre. Presque 40 % des gens sont infectés par le VIH – l'un des taux d'incidence les plus élevés du monde. L'espérance de vie est tombée à 33 ans pour les hommes et 35 ans pour les femmes.
Articles de bulletin
Les raz de marée provoqués par le puissant séisme de magnitude 9,0 qui s'est produit au large de Sumatra le 26 décembre dernier ont fait d'énormes ravages ; tant de souffrances et de morts ont plongé le monde entier dans la douleur.
La corruption a été identifiée comme le principal obstacle à une véritable modification du secteur forestier du Cambodge. Or, non seulement le gouvernement, mais aussi les donateurs internationaux, ont refusé de regarder ce problème en face. Les coûts de la mauvaise gouvernance du secteur forestier, que provoquent la perte de revenus, la destruction des moyens de vie ruraux et les dommages à l'environnement, augmentent sans cesse, de sorte que le Cambodge reste absolument dépendant de l'aide extérieure.
Le 26 novembre 2004, la législature de la province de Santa Fe a approuvé une loi d'urgence environnementale qui établit la suspension absolue de toute activité de coupe, de défrichage, de déforestation, de brûlage ou de destruction de forêts indigènes pendant une période de 180 jours que le pouvoir exécutif peut proroger pour 180 jours supplémentaires.
Dans une lettre ouverte signée par plusieurs organisations et personnalités du Brésil, Rede Alerta contra o Deserto Verde (Réseau Alerte Désert Vert) dénonce et rejette la certification d'une société de plantation, Aracruz Celulose, l'un des plus grands producteurs de pâte d'eucalyptus blanchie de l'état d'Espirito Santo dans le cadre du programme gouvernemental CERFLOR.
La Rainforest Alliance, basée aux États-Unis, conspire contre les efforts des groupes de conservation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour combattre l'extraction forestière illégale et non durable, très répandue dans le pays.
La Conférence des Parties à la Convention sur le Changement climatique de l’ONU se réunira ce mois-ci à Buenos Aires, Argentine. A travers les médias, le public recevra la bonne nouvelle que le Protocole de Kyoto a été approuvé malgré le refus du plus grand pollueur du monde – les États-Unis – de le ratifier. La plupart de gens se sentiront soulagés, croyant que la crise climatique pourra maintenant être évitée.
On dirait que la voie du marché mondial est pavée de bonnes intentions... et de déclarations vides de sens, faudrait-il ajouter.
Comme beaucoup d’autres pays du tiers-monde que les politiques mondiales, colonialistes puis néocolonialistes, ont poussés à la pauvreté et à l’endettement, le Congo a une dette de 4,9 milliards de dollars.
Après avoir subi pendant des décennies la domination despotique de Mobutu Sese Seko, la République démocratique du Congo (RDC, l’ex-Zaïre) a sombré dans une « guerre civile » qui a coûté la vie à trois millions et demi de personnes. Le carnage s’est arrêté dans le pays, mais pour beaucoup ce n’est que temporairement. La guerre a été, en partie du moins, attisée par la compétition pour le contrôle des ressources naturelles.
Le système « shamba » ou « Tongya », appliqué au Kenya, est défini en général comme une forme d’agroforesterie, où les agriculteurs sont encouragés à cultiver des produits de base (maïs, bananes, haricots et manioc) dans des forêts domaniales préalablement défrichées, à condition d’en replanter les arbres. Depuis le milieu du XIXe siècle, le Kenya a utilisé ce système pour établir des plantations forestières destinées à satisfaire la demande de bois en profitant d’une main d’oeuvre bon marché ou même gratuite.
Un projet concernant les Sundarbans, région riche en biodiversité, rencontre la ferme opposition des environnementalistes et de la population locale, qui craignent qu’il ne porte atteinte à la mangrove la plus large du monde.
En partenariat avec l’État, le groupe Sahara, basé à Lucknow, entend lancer un projet « écotouristique » gigantesque et controversé, dont les experts préviennent qu’il ferait plus de mal que de bien à cette région écologiquement fragile.