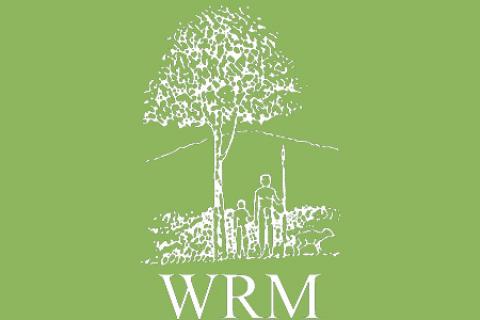Au début des années 90, il a été promu au Costa Rica, en tant que bonne affaire dans le commerce du bois, l'introduction et la culture de l'eucalyptus, une espèce originaire de l'Australie. Cependant, vers la fin des années 90, il s'est avéré que ce modèle de monoculture forestière à grande échelle avait causé de fortes pertes économiques à l'Etat ainsi qu'à un grand nombre d'agriculteurs.
Articles de bulletin
La vie de Bertha Oliva a été marquée par la séquestration et la disparition de son époux, Tomás Nativí, en juin 1981, par les forces de sécurité. En 1982 elle a créé le Comité de Parents de Détenus-Disparus au Honduras (COFADEH), qu'elle dirige encore.
Il y a deux ans, elle s'est engagée dans une nouvelle cause: la défense de l'environnement, à la suite de l'assassinat de deux écologistes dans le département d'Olancho, au Nord-Est du pays, où l'on lutte contre la déforestation qui fait disparaître 80 000 hectares de forêt hondurienne par an.
Le groupe conservationiste nord-américain Conservation International (CI) est en train de demander au gouvernement mexicain d'avoir recours à l'armée nationale afin d'écraser l'Armée zapatiste de libération nationale (EZLN - Ejército Zapatista de Liberación Nacional) une fois pour toutes, d'après les informations du journal mexicain "La Jornada". L'organisation affirme que le groupe guérillero ainsi que les paysans qui occupent "illégalement" la forêt Lacandona sont en train de détruire la forêt tropicale et que cela exige une intervention militaire.
Le PCF (Prototype Carbon Fund) est le fonds de la Banque mondiale qui mobilise des ressources afin de promouvoir le marché de dioxyde de carbone, en fonction duquel les entreprises polluantes -situées majoritairement dans les pays du Nord- peuvent "négocier" des crédits-carbone avec les entrepreneurs forestiers qui théoriquement piègent du carbone -majoritairement situés dans les pays du Sud-.
Plus nombreuses sont les plantations et plus nombreux sont les droits qui se perdent. En Colombie il y a environ 170 000 hectares de palmier à huile plantés. Le témoignage d'un délégué de l'organisation de travailleurs du secteur palmier, concernant entre autres les sociétés Oleaginosas Bucarelia et Oleaginosas Las Brisas, dénonce les mauvaises conditions de travail existantes dans les plantations de palmier à huile dans le département de Santander, en plus des pressions et des encouragements mis en place afin d'affaiblir les syndicats du secteur.
Guyana: Conservation International accusée de "grand manque de respect" envers les peuples indigènes
L'Association de peuples amérindiens (APA) a exprimé sa profonde préoccupation au sujet de la signature d'un Mémorandum d'entente dont l'objectif est d'établir une aire protégée dans la région sud du Guyana et a affirmé que ce mémorandum fait preuve d'un "grand manque de respect" envers les tribus locales.
Au ministère de l'Agriculture du Pérou, il a été affirmé récemment que la coupe illégale de bois, en particulier de l'acajou, pouvait être assimilée au narcotrafic ou à la contrebande, dans le sens où il s'agit d'un réseau organisé et puissant; celui-ci met en péril le processus d'aménagement des forêts démarré par le gouvernement.
Les îles Samoa ont un territoire de 2 935 kilomètres carrés qui comprend deux îles principales, Upolu et Savaii, et sept autres îles plus petites. Plus de deux tiers des 178 000 habitants du pays vivent à Upolu. Les régions montagneuses centrales d'Upolu et de Savaii sont faiblement peuplées. La majorité de la population se concentre sur la côte. Plus de 81% des terres du pays se trouvent sous le régime de tenure de droit coutumier, et le reste est partagé entre le gouvernement (11%), la Samoa Land Corporation (5%) et des propriétaires privés (3%).
Les activistes sudafricains luttent depuis des années contre la diffusion des plantations industrielles d'arbres exotiques. Wally Menne, de Timbarwatch Coalition, dit que "la certification par le FSC de monocultures d'espèces ligneuses comme des 'forêts gérées de façon durable' tourne en ridicule le concept de gestion durable de l'environnement et de l'écosystème".
L'assemblée générale du Conseil de bonne gestion forestière (Forest Stewardship Council, en abrégé FSC) se tiendra au cours de ce mois à Oaxaca, Mexico, et nous souhaitons faire part à ses membres, et en particulier aux organisations sociales et environnementales, de notre inquiétude autour de la certification de plantations.
Le Liberia abrite les deux derniers blocs importants de forêt pluviale tropicale couverte subsistant dans la forêt de Haute Guinée en Afrique occidentale. La forêt de Haute Guinée, reconnue comme l'un des vingt-cinq points névralgiques de la biodiversité mondiale, est constituée d'une ceinture de forêts fragmentées courant le long de la côte ouest africaine. Couvrant la totalité ou une partie de quelques dix pays, elle commence au niveau de la Guinée à l'ouest, pour se terminer au sud-ouest du Cameroun à son extrémité est.
Les Etats indépendants ont été peu nombreux à s'intéresser au renforcement des systèmes d'autorité locaux, expressément détruits par les régimes coloniaux. Les nouveaux Etats indépendants, de même que les régimes coloniaux du passé, ne voient pas avec de bons yeux le fait que les forces politiques locales puissent mettre en cause leur légitimité. C'est ainsi que beaucoup de forêts sont devenues propriété de l'Etat. C'est le cas de la Tanzanie.