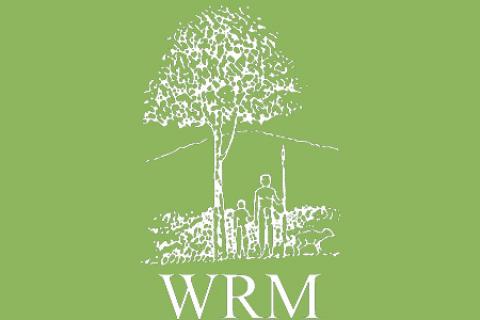Le mois dernier, un nouveau partenariat pour le carbone forestier de l’Australie et l’Indonésie a été annoncé dans le cadre de l’Initiative internationale sur le carbone forestier, une initiative gouvernementale gérée par l’AusAID et le Département du changement climatique.
Articles de bulletin
Le concept de zone protégée, né au 19e siècle aux États-Unis pour désigner la conservation au moyen de l’établissement de « parcs nationaux », fit partie de la colonisation de « l’Ouest sauvage » et il a souvent servi depuis à s’approprier des territoires qui appartenaient aux autochtones pour les mettre sous le contrôle d’États, de centres de recherche ou d’entreprises.
El Pambilar est entré dans les annales de l’Équateur parce qu’il s’agit d’une forêt indigène de 3 123 hectares que les paysans et l’entreprise forestière Bosques Tropicales S.A. Botrosa, du groupe Peña Durini, se disputent depuis 1997.
Après l’échec fracassant et annoncé de la Convention des Nations unies sur les changements climatiques qui s’est réunie à Copenhague en décembre 2009, le président de la Bolivie, Evo Morales, a pris l’initiative de convoquer un sommet d’un autre genre pour chercher des solutions.
Les solutions inefficaces et injustes au problème du changement climatique, par lesquelles ont prétend maintenir le statu quo au moyen des compensations et du commerce du carbone, sont de plus en plus critiquées par la société civile mondiale.
Il est évident pour tous que nous sommes embarqués dans un long et parfois résisté processus de prise de conscience des relations sociales entre les sexes, dans lesquelles, de façon générale, la femme a toujours été en situation d’inégalité et de subordination.
Les femmes jouent souvent un rôle crucial dans les conflits environnementaux liés à l’extraction du pétrole, aux activités minières, à l’exploitation forestière, à l’aquaculture de crevettes et aux plantations d’arbres. Ces femmes courageuses n’hésitent pas à défier les pouvoirs politiques, les tyrans locaux et la violence armée pour protéger les ressources naturelles dont elles et leurs familles dépendent. Elles protègent leur culture, leur façon de vivre, les lieux sacrés et leurs moyens de subsistance.
Les Nations unies ont proclamé 2010 Année internationale de la diversité biologique. D’après son site Web officiel, « C’est une célébration de la vie sur la Terre et de la valeur de la biodiversité pour nos vies. Le monde est invité à prendre des mesures en 2010 pour sauvegarder la diversité de la vie sur Terre : la biodiversité ».
L’Afrique est riche en mangroves : s’étendant de la Mauritanie à l’Angola sur la côte atlantique et de la Somalie à l’Afrique du Sud le long de l’Océan indien, elles couvrent plus de 3,2 millions d’hectares.
Les dernières forêts du Bangladesh sont en train de disparaître, et il est fréquent qu’on en blâme l’agriculture sur brûlis que pratiquent les populations locales. Le gouvernement, à l’aide de prêts et de fonds fournis par les institutions financières bilatérales et multilatérales, encourage activement la plantation d’arbres, ce qui indiquerait qu’il essaie de redresser la situation.
Un article publié par le périodique La Tercera [1] et repris dans le blog mapuche IMC [2] révèle les résultats d’une investigation menée par des chercheurs de l’Université Australe de Valdivia, selon laquelle la présence de la forêt indigène est associée à une plus forte production d’eau.
Le tsunami de décembre 2004 qui ravagea plusieurs côtes asiatiques permit de voir à quel point l’homme avait détruit les mangroves, ces ceintures vertes protectrices du littoral. Le besoin de restaurer ces ceintures protectrices naturelles se fit sentir, mais les tentatives dans ce sens n’eurent pas beaucoup de succès.
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- …
- Page suivante
- Dernière page