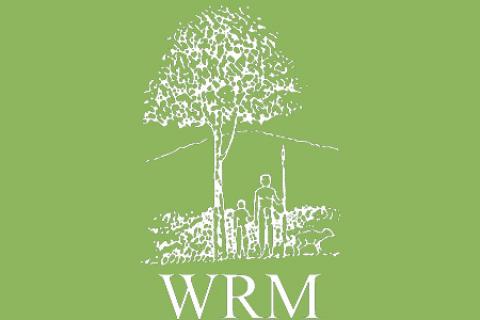Dès qu’un nouveau processus est lancé, les ONG doivent décider si elles y participent ou non. C’est ce qui arrive maintenant avec l’approche fondée sur les hautes valeurs pour la conservation (HVC) et avec le Réseau sur les ressources HVC.
L’éditorial qui précède énumère une série de questions sérieuses dont il faut discuter en profondeur pour pouvoir prendre à ce sujet une décision bien fondée.
Articles de bulletin
La nouvelle politique en matière de forêts (PO 4.36) adoptée en 2002 par la Banque mondiale établit que « la Banque ne finance pas les projets qui, à son avis, impliqueraient une conversion ou une dégradation importante de sites forestiers critiques ou d’habitats forestiers critiques ». Néanmoins, dans les cinq années qui ont suivi et malgré les demandes réitérées d’ONG comme le WRM, la Banque n’a jamais été en mesure d’expliquer comment elle détermine quels sites sont « critiques ».
Le concept de FHVC est appliqué en Indonésie depuis cinq ans, pour essayer d’identifier les forêts de haute valeur pour la conservation et d’éviter qu’elles soient transformées en plantations d’arbres pour la fabrication de pâte à papier. Les plus grands producteurs de pâte de l’Indonésie, APP et APRIL, ont répondu aux pressions du marché orchestrées par le WWF et les organisations affiliées aux Amis de la Terre en faisant et en commandant des évaluations de la valeur des forêts dans les zones boisées qu’il était prévu de transformer en plantations d’acacias.
L’Indonésie possède quelques-unes des forêts tropicales les plus riches en diversité biologique, mais aussi le taux de déboisement le plus élevé du monde. Le concept de FHVC (forêt de haute valeur pour la conservation) y a fait son chemin comme un moyen de réconcilier les pressions économiques pour ouvrir les zones boisées avec le besoin de ralentir le rythme de disparition des forêts.
Les gouvernements du Cambodge, de la Chine, du Laos, de la Thaïlande et du Vietnam sont en train de promouvoir l’établissement de plantations industrielles d’hévéas, de palmiers à huile, d’eucalyptus et de pins. Pourtant, les villageois affectés sont en train de manifester ouvertement leur mécontentement. Au cours d’une réunion organisée le mois dernier au Cambodge nous avons appris que les communautés locales s’opposaient avec force à ces projets parce qu’elles voyaient que les plantations envahissaient leurs terres et portaient atteinte à leurs moyens de vie.
La Gambie est un petit pays (10 000 km2), pauvre du point de vue économique et qui se heurte à plusieurs problèmes d’ordre environnemental et social. Parmi les premiers, le déboisement est probablement le plus dangereux pour l’écologie et la population. Jusqu’au début des années 1900, la Gambie était couverte de forêts denses. En 1981, près de 45 % (430 000 ha) de la superficie du pays étaient classés comme terres boisées. En 1988, ce chiffre était tombé à 340 000 ha, soit 30 % des terres.
Une entreprise sucrière ougandaise projette d’élargir son domaine en détruisant 7 000 hectares, soit près d’un tiers, de la forêt Mabira, l’une des rares forêts intactes qui restent sur les bords du lac Victoria, où habitent des espèces uniques d’oiseaux et de singes.
Ce plan a suscité une forte controverse, du fait qu’il menace des centaines d’espèces uniques confinées dans des étendues de plus en plus réduites de forêt tropicale et qu’il risque d’affecter la régime des pluies dans une région déjà atteinte par la sécheresse en raison du changement climatique.
Une entreprise sucrière ougandaise projette d’élargir son domaine en détruisant 7 000 hectares, soit près d’un tiers, de la forêt Mabira, l’une des rares forêts intactes qui restent sur les bords du lac Victoria, où habitent des espèces uniques d’oiseaux et de singes.
Ce plan a suscité une forte controverse, du fait qu’il menace des centaines d’espèces uniques confinées dans des étendues de plus en plus réduites de forêt tropicale et qu’il risque d’affecter la régime des pluies dans une région déjà atteinte par la sécheresse en raison du changement climatique.
En 1997, la Convention des Nations unies sur le changement climatique mit en place le Protocole de Kyoto pour limiter les émissions de carbone responsables du réchauffement de la planète. Depuis, la situation s’est aggravée, les effets du dérèglement du climat s’étant accélérés. Pourtant, dans les conférences on parle surtout des « opportunités » d’affaires qu’offre la catastrophe climatique.
Les projets forestiers de stockage de carbone ont fait une entrée tardive dans le marché du MDP parce qu’ils sont très controversés. Le cadre juridique nécessaire, formulé en 2001 lors des accords de Marrakech, n’a été adopté qu’à la fin de 2005, au cours des négociations de Montréal sur le climat. Ainsi, il n’y a rien de concret à signaler pour l’instant.
Depuis 1994, une organisation néerlandaise dénommée Fondation FACE travaille au Parc national du mont Elgon, en collaboration avec le Service ougandais de la Faune (UWA), responsable de la gestion des parcs nationaux du pays. Le projet UWA-FACE prévoit de planter des arbres sur une étendue de 25 000 hectares juste à l’intérieur des limites du parc national. À ce jour, UWA-FACE a planté 8 500 hectares.
La douzième session de la conférence des parties sur le changement climatique (CdP 12) s’est terminée il y a quelques jours. Une fois de plus, on a pu constater que les gouvernements et les parties concernées ont très peu d’intérêt à chercher des solutions tranchantes à la crise climatique à laquelle nous assistons.