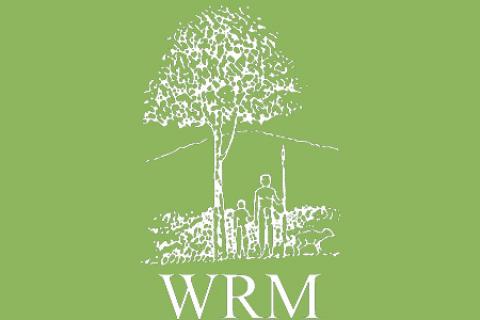La monoculture est le principal moyen dont dispose le grand capital transnational pour s’approprier et contrôler les terres et la main d’oeuvre bon marché des pays du Sud, et cela porte un préjudice énorme à la diversité biologique et culturelle. L’homogénéisation et la simplification radicale des écosystèmes agricoles leur permettent de maximiser l’exploitation du sol et celle de la main d’oeuvre grâce à la mécanisation des tâches qui facilite leur contrôle et leur supervision.
Articles de bulletin
La lutte des indigènes tupiniquim et guarani se retrouve aujourd’hui dans une situation très difficile. Après avoir démarré en février 2005, lorsque ces peuples ont décidé de récupérer les terres occupées par les plantations d’eucalyptus de l’entreprise Aracruz Celulose, cette lutte avait permis à plus de 100 familles de se réinstaller dans le milieu rural dont elles avaient été expulsées et de retrouver l’espoir d’un avenir digne et durable (voir les bulletins 94, 96 et 101 du WRM).
Fin décembre, l’Ibama (Institut brésilien de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables) a condamné Veracel Celulose au paiement d’une amende de R$ 320 000. L’Ibama avait constaté, au moyen d’images satellite et de GPS, des irrégularités commises par l’entreprise, consistant à empêcher ou gêner la régénération naturelle de la “Mata Atlântica” (forêt atlantique brésilienne) sur 1 200 hectares et aggravant encore plus la situation de ce biome. Une fois encore, la fausseté de Veracel, qui se déclare protectrice de la “Mata Atlântica”, se voit démasquée.
Aucun projet de loi sur une question environnementale n’a peut-être soulevé autant de discussions au parlement colombien que la Loi forestière générale approuvée par cet organe au mois de décembre. Les arguments et la réponse des environnementalistes colombiens, du mouvement social et même d’une partie des médias ont été si forts que, pour la première fois, le président Álvaro Uribe Vélez a retourné la loi au Congrès de la République.
La sieste estivale traditionnelle du mois de janvier en Uruguay s’est vue interrompue non seulement par les pluies permanentes mais par l’avancée sans trêve des industries de la pâte. Leur campagne publicitaire se poursuit à coups de mensonges qui sont ensuite repris comme des vérités. Autant de promesses et de mirages adressés à une population où le taux de chômage est élevé et qui a besoin urgent de solutions.
« La ville de Vitória, au Brésil, doit son nom à la ‘victoire’ remportée par les colonisateurs portugais contre les habitants autochtones de la région. Aujourd’hui, ce nom a un sens tout à fait différent. Les peuples indigènes Tupinikim et Guarani ont repris les terres qui leur avaient été volées par le géant de la pâte à papier, Aracruz Celulose. Ils ont été rejoints dans leur combat contre cette société et ses usines par d’autres collectivités locales et des organisations de la société civile qui, grâce à leur union, ont réussi à affaiblir son pouvoir.
Les effets négatifs des plantations d’arbres sur les forêts et leurs habitants ont été signalés par le WRM depuis sa création en 1986. La « Déclaration de Penang » de 1989, qui reflétait le point de vue des membres du WRM, identifiait les plantations comme « faisant partie des politiques et des pratiques qui, au nom de la croissance, mènent au déboisement dans le monde entier ».
Depuis ses débuts en 1986, le Mouvement mondial pour les forêts tropicale s’inquiète de la manière dont les forêts, les terres et les vies des habitants de la campagne sont affectées par la production industrielle de toute une série de produits : le soja, la pâte à papier, le pétrole, le bois d’oeuvre, l’huile de palme, le maïs, les bananes, le café et bien d’autres.
L’Initiative de Mumbai–Porto Alegre (MPA) pour les forêts a été conçue comme une plateforme pour le rassemblement de forces et l’établissement de liens solidaires entre les divers acteurs qui s’occupent d’un large éventail de thèmes dans les domaines des forêts, de la justice sociale et de la justice environnementale. La mondialisation économique portant de plus en plus atteinte aux collectivités locales, le besoin de créer un mouvement mondial pour défendre les droits des peuples et la conservation des forêts est devenu impératif.
L’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a rapporté qu’il existe des essais de terrain d’arbres GM dans 16 pays. La plupart se trouvent aux États-Unis ; les autres pays de la liste sont la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Espagne, le Portugal, la Finlande, la Suède, le Canada, l’Australie, l’Inde, l’Afrique du Sud, l’Indonésie, le Chili, le Brésil et la Chine. La Chine est le seul pays dont on sait qu’il a développé des plantations commerciales d’arbres GM ; plus d’un million de ces arbres ont été plantés dans dix provinces.
La déclaration suivante a été émise le 24/11/05 à Vitória, Espírito Santo, Brésil, lors d’une rencontre internationale destinée à soutenir les communautés locales contre les plantations d’arbres à grande échelle et contre les arbres GM. La réunion a été co-organisée par le Mouvement mondial pour les forêts tropicales, FASE-ES et Global Justice Ecology Project.
L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) vient de publier son Évaluation des ressources forestières mondiales 2005. Le communiqué de presse correspondant commence par une déclaration inquiétante : « La déforestation se poursuit à un rythme alarmant », mais la suite nous rassure immédiatement, car nous y apprenons que « Néanmoins, le taux de pertes nettes de forêts ralentit ». Beaucoup trouveront cela quelque peu sibyllin.