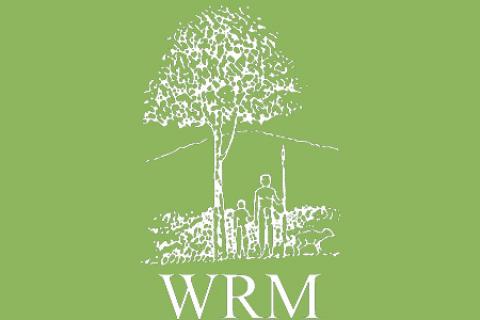L’usine de production de pâte de papier de Valdivia, Celulosas Arauco y Constitución (CELCO), qui appartient au groupe chilien Angelini, a récemment repris ses activités, après une fermeture de 64 jours due au scandale suscité par la mort des cygnes à col noir de la réserve du fleuve Cruces, où elle déverse ses eaux usées.
Articles de bulletin
Sur les 3 500 millions d’hectares de forêts qui existent dans le monde, près de 63 millions sont en Colombie et la moitié d’entre elles se trouvent dans des territoires que les cultures indigènes et les communautés noires ont enrichis. Ces forêts abritent une diversité biologique qui est parmi les plus riches du monde, et elles sont le soutien des nombreuses cultures qui les habitent. D’autre part, elles interviennent dans le système climatique et hydrologique et sont l’habitat de formes de vie complexes et irremplaçables.
Dans l’Amazonie péruvienne, l’exploitation forestière est fortement sélective, c’est-à-dire que, parmi la grande variété d’essences qu’on y trouve, seules quelques-unes sont utilisées. Les stocks en sont donc réduits et, pour trouver certaines d’entre elles (l’acajou par exemple), les exploitants n’hésitent pas à envahir les zones réservées.
La plus grande papeterie japonaise, Nippon Paper (NP) est considérée comme une entreprise leader en matière de réformes environnementales, mais à quel point est-ce vrai ?
South East Fibre Exports de la région d’Eden, environ 500 km au sud de Sydney, est une filiale de NP.
Cette usine de production de particules, la plus ancienne de l’Australie, avait été la première initiative à l’étranger de la société Daishowa Paper Manufacturing Company. Il y a deux ou trois ans, NP l’a rachetée.
Les entreprises et les gouvernements concernés par le commerce international des bois tropicaux ont bien mérité leur mauvaise image. La plupart de leurs activités, souvent fondées sur la corruption, ont provoqué une destruction généralisée des forêts et la violation des droits de l’homme dans de nombreux pays. À présent, quelques-uns de ces acteurs semblent disposés – après avoir été la cible de fortes campagnes des ONG – à améliorer leurs performances, aussi bien dans le domaine de l’exploitation forestière que dans celui du commerce international du bois.
Est-ce la dichotomie exploitation légale – exploitation illégale qui devrait dominer dans une politique de conservation des forêts ? L’exploitation illégale a lieu lorsque le bois – devenu un produit rentable à commercialiser – est récolté, transporté, acheté ou vendu en contravention des lois nationales. Mais les lois différant beaucoup d’un pays à l’autre, il n’est pas possible de distinguer, à l’échelon mondial, l’exploitation légale de l’exploitation illégale, dans la mesure où il n’existe pas de normes internationales à ce sujet.
L’exploitation forestière illégale est sans doute le problème du secteur forestier le plus débattu ces derniers temps au niveau international ; il n’a cessé d’attirer de plus en plus d’attention au cours des dix dernières années. Les gouvernements, les industries forestières, les bailleurs de fonds et les ONG semblent d’accord qu’il s’agit là d’une des questions les plus importantes à résoudre. Le problème a été débattu à des réunions de haut niveau.
Les ONG européennes estiment que plus de 50 % des importations de bois tropical de l’UE et plus de 20 % de celles en provenance des forêts boréales sont d’origine illégale. D’autre part, on estime que, dans plusieurs pays européens et en particulier dans la Baltique et en Europe orientale, l’exploitation forestière est clandestine à 50 %. L’Union européenne ne possédant pas d’instruments de contrôle des importations de bois, elle blanchit chaque année de grands volumes de bois d’origine illégale.
Les forêts subviennent aux besoins de subsistance de centaines de millions de personnes partout dans le monde et, en particulier, dans les régions tropicales. Toute activité qui comporte le déboisement ou la dégradation de la forêt aura donc des effets directs sur les moyens de survie et sur la santé de ces personnes.
La forêt est le berceau de la diversité, ce qui équivaut à dire qu’elle est source de vie. Quand la forêt est saine, l’eau en surgit, l’air devient plus pur et parfumé, elle nous fournit des possibilités d’abri et nous offre de la nourriture, l’art s’y exprime dans la myriade de couleurs et de nuances qui se déploient et se cachent d’un cycle à l’autre et, au milieu de toute cette beauté et de cette prodigalité, il est possible de ressentir en quelque sorte l’amour de la nature pour tous les êtres qui la composent.
En Tasmanie, la superficie de forêts indigènes et de fermes transformées en plantations d’arbres en régime de monoculture s’est presque quadruplée entre 1994 et 2004, atteignant 207 000 hectares.
La plupart des fermes en question étaient de type organique ou utilisaient relativement peu de produits chimiques par rapport aux fortes doses requises par les monocultures d’arbres qui les ont remplacées.
L’annexion du territoire mapuche à l’État chilien et l’imposition du système juridique de ce dernier à tous les peuples originaires qui coexistent dans le pays ont profondément changé le mode de vie des Mapuche. Entre 1881 et 1907, dépouillée de son territoire, de son autonomie et des biens qu’elle générait en tant que société agricole, la population mapuche a été la proie de famines et de maladies qui ont fait environ vingt mille victimes.