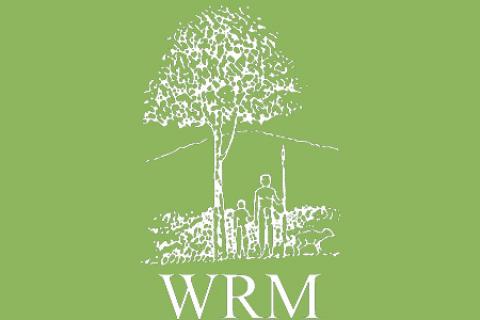Lorsque le secrétaire d’État Colin Powell a présenté, en début d’année, le rapport 2003 du ministère des Affaires étrangères des États-Unis sur les droits de l’homme, il espérait sans doute que le scandale des tortures systématiques des prisonniers irakiens par les forces armées de son pays ne verrait jamais le jour. « Le président Bush considère la défense et la promotion des droits de l’homme comme la vocation particulière des États-Unis », avait-il dit.
Articles de bulletin
La réponse du gouvernement vietnamien aux manifestations pacifiques des peuples autochtones, qui ont eu lieu en avril dans les Hauts Plateaux du centre du pays, a été brutale. La police a utilisé des gaz lacrymogènes, des matraques électriques et des lances à eau pour empêcher les manifestants d’entrer dans Buon Ma Thuot, capitale de la province de Dak Lak. Les policiers étaient aidés par des hommes armés de barres métalliques, de pelles et de machettes. Il y a eu au moins dix morts et des centaines de blessés.
Le 17 avril, plus de 400 soldats des forces spéciales de l’armée équatorienne sont entrés au Détachement Tigre, situé sur la frontière sud-est du Pérou, province de Pastaza, soi-disant pour « capturer, neutraliser et anéantir deux groupes guérilleros » détectés dans la région. Ce territoire appartient à la communauté quichua Yana Yaku, siège de l’Organisation des Peuples autochtones de Pastaza (OPIP), elle aussi occupée le même jour par surprise par 80 militaires, accusée d’être le « foyer de l’appui logistique » de groupes prétendument subversifs.
Nous venons de recevoir l’excellente nouvelle que Floresmilo Villalta a été mis en liberté le vendredi 21 mai, et qu’il est immédiatement retourné dans la communauté de Las Golondrinas pour rejoindre sa famille et ses amis.
Les Twa étaient les premiers habitants des forêts équatoriales de la région des Grands Lacs. Occupant au départ les forêts de montagne de la région de l’Albertine Rift, ils s’adonnaient à la chasse et à la cueillette. À présent, les Twa des Grands Lacs d’Afrique centrale habitent le Burundi, l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), le Rwanda et le Sud-ouest de l’Ouganda.
À beaucoup d’égards, il y a très peu de différences entre le Swaziland et l’Afrique du Sud, qui partagent un climat, une topographie et une géologie semblables. Il n’est donc pas étonnant que la végétation naturelle du Swaziland ressemble de près à celle que l’on trouve dans les provinces sud-africaines de KwaZulu-Natal et Mpumalanga, qui entourent presque le royaume swazi.
En septembre 2003 nous avions informé sur un ravageur exotique qui avait attaqué les eucalyptus dans la région ouest du Kenya, et nous avions étudié les risques inhérents au modèle de plantation en monoculture (voir bulletin nº 74 du WRM).
À présent, les dégâts ont atteint l’Ouganda voisin, où les districts les plus touchés ont été Mpigi, Luweero, Masaka, Kasese, Mbarara, Bushenyi, Mbale, Kapchwora, Tororo, Lira et Apac.
Les forêts asiatiques sont détruites à une vitesse ahurissante. La Chine, qui est devenue du jour au lendemain le deuxième importateur de bois du monde, devancée seulement par les États-Unis, y est sans doute pour quelque chose. Le volume de rondins arrivant en Chine a plus que triplé depuis 1998 et dépasse actuellement les 15 millions de mètres cubes.
La Patagonie argentine est une vaste région de 800 891 km2 qui comprend une grande variété d’écosystèmes. Du point de vue topographique, on distingue deux territoires différents : la région andine (qui correspond aux Andes australes, avec leurs forêts, lacs et fleuves) et la région extra-andine (des steppes et des plateaux).
La troisième rencontre convoquée par le réseau « Alerta Contra o Deserto Verde » s’est tenue les 6 et 7 mai dans la ville de Belo Horizonte (État de Minas Gerais), en présence du délégué du ministère de l’Environnement du Brésil. Le réseau, qui regroupe plus de 100 organisations, avait convoqué des dizaines de représentants du Mouvement des sans-terre, paysans, peuples autochtones, quilombolas (communautés afro-brésiliennes), petits agriculteurs et mouvements sociaux des États de Minas Gerais, Espirito Santo, Bahia et Rio de Janeiro.
Le 17 avril, plus de 400 soldats des forces spéciales de l’armée équatorienne sont entrés au Détachement Tigre, situé sur la frontière sud-est du Pérou, province de Pastaza, soi-disant pour « capturer, neutraliser et anéantir deux groupes guérilleros » détectés dans la région. Ce territoire appartient à la communauté quichua Yana Yaku, siège de l’Organisation des Peuples autochtones de Pastaza (OPIP), elle aussi occupée le même jour par surprise par 80 militaires, accusée d’être le « foyer de l’appui logistique » de groupes prétendument subversifs.
La Réserve naturelle de Galibi est mondialement célèbre en tant que lieu de ponte de quatre espèces de tortues menacées. Établie en 1969, elle couvre environ 400 hectares et reçoit une affluence permanente de touristes des États-Unis et de partout ailleurs.
Pourtant, ce qui est moins bien connu est que’elle fait partie du territoire ancestral des Kalinya du Bas Marowijne River, et que ce peuple a directement subi les conséquences de l’établissement de cette aire protégée.