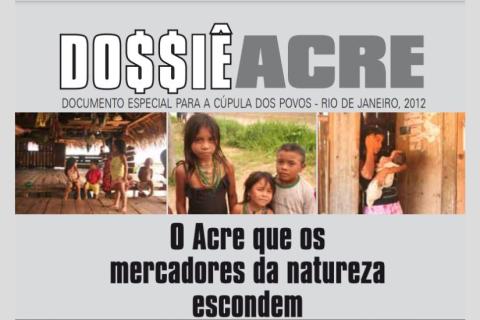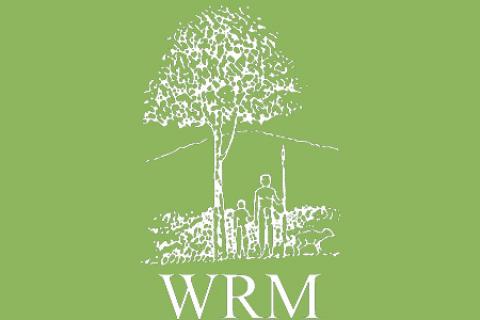Des faits associés à la conférence Rio+20, comme l’expulsion d’un activiste mozambicain et la réalité de la situation que certains sponsors de l’évènement officiel font subir aux populations locales, montrent que le pouvoir des grandes entreprises n’a pas de limites.
Articles de bulletin
Quiconque était à Rio de Janeiro entre le 15 et le 23 juin a pu observer trois processus parallèles et différents, mais connectés entre eux.
La société philippine A. Brown Company Inc. s’occupe de la plantation et du traitement de palmiers à huile. En 2010, elle a commencé à planter des palmiers sur 520 hectares de terres publiques réclamées par le peuple indigène des Higaonon.
Dans le cadre du Sommet des Peuples organisé pendant Rio+20, une campagne mondiale contre les transnationales a été lancée, sous le slogan « Démantelons le pouvoir des multinationales et mettons fin à l’impunité ». La campagne a pour but d’unir les centaines de campagnes, de réseaux, de mouvements sociaux et d’organisations qui luttent contre les atteintes des transnationales aux droits de l’homme, à la nature et à la planète.
Des alliés de 26 pays d’Asie, d’Afrique, d’Amérique et d’Europe se sont réunis en Indonésie, dans le Sumatra occidental, du 10 au 15 juillet 2012, convoqués par La Vía Campesina et la Campagne mondiale pour la réforme agraire, pour traiter du thème « La réforme agraire et la défense de la terre et des territoires au 21e siècle : enjeux et avenir ».
L’organisation Salva la Selva a lancé une campagne pour exiger de la Deutsche Bank de se dissocier du géant huilier malaisien FELDA Global Ventures Holding, qui souhaite obtenir trois milliards de dollars par son entrée en bourse et les affecter à la réalisation de nouvelles plantations de palmier à huile en Indonésie et en Afrique. Des forêts tropicales seront achetées, détruites et transformées en énormes plantations industrielles.
Au Chili, de grands groupes économiques forestiers ont foncé sur les terres avec l’appui de l’État, de sorte que plus de 3 millions d’hectares sont couverts à présent de plantations industrielles de pins et d’eucalyptus.
Les plantations d’arbres ont rapporté des milliards à des groupes tels que Matte, propriétaire de Forestal Mininco CMPC, ou Angelini, propriétaire de Forestal Arauco.
Des transnationales aussi peu recommandables que BP, Dow et BP sont en train de sponsoriser les Jeux olympiques, les utilisant comme paravent pour dissimuler les violations des droits de l’homme et les atteintes à l’environnement qu’elles commettent dans le monde entier.
Au moment où nous publions ce bulletin, le Sommet des Peuples commence au Brésil. En mai, dans sa réunion de préparation de Rio+20, le Groupe de coordination internationale du Comité facilitateur du Sommet des Peuples pour la société civile, dont le WRM fait partie, lança un appel à l’unité et à la mobilisation des peuples, pour la vie et pour les biens communs, pour la justice sociale et environnementale, contre la marchandisation de la nature et contre « l’économie verte ». Nous souhaitons faire part à nos lecteurs de cet appel international.
Dans quelques jours commencera à Rio de Janeiro, au Brésil, la conférence dénommée Rio+20. Dans cette même ville, il y a 20 ans, eut lieu le Sommet de la Terre, ou Sommet de Rio, ou Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement, le premier grand sommet mondial avec 8 000 délégués officiels inscrits, auquel assistèrent 108 chefs d’État ; parallèlement, un forum de la société civile fut organisé, qui réunit plus de 5 000 participants.
Énergie durable pour tous (SEFA d’après l’anglais) est une initiative lancée par le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, en octobre 2011, qui a gagné du terrain à l’approche de Rio+20. Ban Ki-moon a précisé qu’à son avis, elle occupera le devant de la scène à Rio+20 et qu’elle suivra son cours, quel que soit le résultat des négociations de l’ONU.
Les objectifs officiels de SEFA pour 2030 sont : a) de doubler le taux d’amélioration de l’efficacité énergétique ; b) de doubler la part de l’énergie renouvelable ; c) d’assurer l’accès universel aux services énergétiques modernes.
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- …
- Page suivante
- Dernière page